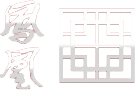La science-fiction littéraire au Japon avec Denis Taillandier

En vous renseignant un peu sur le Japon, n'avez-vous jamais eu la sensation que les Japonais vivaient dans le futur ? Cliché ou réalité, le fait est que nous n'avons aucun mal à associer ce pays à quelque chose de science-fictionnel. D'autant que les mangas, les anime et les jeux vidéos produits par le Japon ou se déroulant dans un univers japonisant font partie intégrante de notre imaginaire. Godzilla, Goldorak, Capitaine Flamme, Akira ont marqué et marquent toujours des générations. Dans cet entretien, il sera bien question de SF mais principalement en ce qui concerne la littérature, moins souvent mise en avant. Denis Tallandier est traducteur de littérature japonaise et spécialiste de la science-fiction japonaise. Il a publié deux anthologies co-dirigée et co-traduite avec Tony Sanchez aux éditions Akatombo : La machine à indifférence et le Chant d'Auricularia.
Denis Taillandier est maître de conférences à la faculté des relations internationales de l’Université Ritsumeikan (Kyoto). Il a obtenu son doctorat à l’Université Jean Moulin Lyon III (IETT) en 2015 avec une thèse sur les représentations des nanotechnologies dans la science-fiction japonaise. Ses travaux portent sur l’imaginaire des sciences et des technologies dans le Japon contemporain. Il a remporté en 2013 le prix spécial du jury pour le 8ème concours de critique de science-fiction au Japon. Il a également traduit en français les nouvelles d’écrivains tels que Hoshi Shin’ichi, Aramaki Yoshio, Ueda Sayuri, Fujii Taiyō, Miyauchi Yūsuke, EnJoe Toh et Tobi Hirotaka.

1. Quand et comment la littérature de science-fiction est-elle arrivée au Japon ?
Le critique Nagayama Yasuo n’hésite pas à en rechercher les origines jusque dans le Nihon Shoki (Chroniques du Japon, 8ème siècle), avec notamment la légende d’Urashima Tarô ; personnage mythique qui, pour avoir sauvé la fille du roi des océans, se voit récompenser par lui d’un séjour dans son palais divin. Il s’aperçoit à son retour que le temps s’est écoulé bien plus rapidement à l’extérieur, et que tous ses contemporains sont morts depuis bien longtemps. Nagayama met aussi en avant le Taketori monogatari (Le Conte du Coupeur de bambou, 10ème siècle) qui raconte comment la princesse Kaguya, originaire de la lune (Tsuki no miyako) mais réfugiée sur terre, finit par s’en retourner auprès des siens.
Toutefois Nagayama n’oublie pas de rappeler que le terme de « science-fiction » est une invention des années 1920 et que le mot ne sera adopté au Japon qu’au début des années soixante, à l’occasion de la création du premier magazine professionnel de science-fiction : SF magajin. Or il est à noter que l’adoption tardive du terme n’indique bien évidemment pas que le genre prit forme exclusivement dans l’après-guerre. Bien au contraire, les œuvres que l’on désigne aujourd’hui sous le terme de « SF classique » ou « proto-SF » (koten SF) sont apparues à l’ère Meiji (1968-1912). Popularisées dès 1886 en tant que « romans scientifiques »1 , ces productions inédites puisent leurs influences dans les textes d’Edgar Allan Poe, d’H. G. Wells mais surtout au cœur des romans de Jules Verne2. Elles se voient affubler en 1932 du préfixe « imaginaires » (kûsô kagaku shôsetsu), en écho au Wonder Stories de Gernsback, et pour les différencier des récits de vulgarisation scientifique. Les premières œuvres de science-fiction japonaise virent donc le jour entre la fin d’Edo (1603-1868) et le début de Meiji, notamment avec Seiseikaishin-hen (Récits d’une victoire gratifiante sur l’Ouest) d’Iwagaki Gesshû en 1854, et Ukishiro Monogatari (Récits du château flottant) de Yano Ryûkei en 1890.
Après une période d’isolement politique, le Japon de Meiji s’ouvre au monde et entre dans une période de modernisation extrêmement rapide. Tandis qu’au plan politique et institutionnel le pays évolue vers la mise en place d’un gouvernement représentatif, la littérature va épouser les mouvements de l’histoire. Les romans d’aventure, jadis prisés du public, font alors peu à peu place au roman politique. Or, les débats autour de la rédaction d’une Constitution et de la création d’une assemblée nationale font rages, des critiques s’élèvent et des rassemblements publics se multiplient jusqu’à ce que le gouvernement ne les interdise. Afin d’échapper à la censure, les romans politiques font un usage habile et répété d’un futur envisagé en tant que cadre narratif, qui leur imprime ainsi un « avant » goût de science-fiction.
Cependant, l’apparition de critiques littéraires, quoique qu’ils contribuent par la suite à l’essor du roman au Japon, fit frein au développement de la science-fiction. Dans son essai L’Essence du Roman publié en 1885, Tsubouchi Shôyô fait l’apologie du réalisme fondé sur une description de la réalité des émotions humaines. Le critique invite ainsi le lecteur à se désintéresser du roman du futur qu’il juge incapable de remplir la mission du portrait des émotions humaines puisqu’il se fonde exclusivement sur des idées et se détourne donc de la réalité.
Il faudra attendre le début du 20ème siècle pour voir réapparaître des œuvres au décor futuriste, celles-ci étant pour la plupart préoccupées par le thème de la guerre. Mais c’est au début de l’ère Shôwa (1926-1989) que la science-fiction s’établit en tant que genre avec la création en 1920 du magazine Shinseinen qui offrit un espace littéraire dédié au roman policier (tantei shôsetsu). Son éditeur, Kôga Saburô, le divisa en deux genres distincts : le roman policier ordinaire ou « orthodoxe » (honkaku) et le roman policier extraordinaire ou « hétérodoxe » (henkaku). Le premier s’appliquait aux histoires traditionnelles dont l’intrigue reposait sur la résolution d’enquêtes policières, tandis que le second regroupait tous les autres genres, dont la science-fiction.
En outre, le magazine Kagakuhô, fondé en 1927, soit une année après la première publication d’Amazing Stories aux Etats-Unis, élargit à son tour cet espace littéraire consacré à la nouveauté. L’objectif avoué de ce nouveau magazine était de rechercher des ouvrages révolutionnaires, de grande qualité littéraire, faisant usage de ressources scientifiques mais sans verser dans le style policier. Le genre souffrira cependant de la montée au pouvoir du gouvernement militariste vers la fin des années 1930, puis se verra largement censuré pendant la Seconde Guerre Mondiale.
2. Peut-on parler d’une science-fiction japonaise ? Si oui, quelles en sont les thématiques récurrentes ?
Il est difficile d’apporter une réponse claire à cette question… Il existe bel et bien une science-fiction japonaise dans la mesure où des auteurs et autrices japonais en écrivent, mais les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de mettre en exergue une ou plusieurs spécificités. Le genre s’est construit autour de ce que Damien Broderick appelle un « méga-texte » : un gigantesque corpus d’œuvres qui se sont inspirées les unes des autres et ont contribué à l’émergence de représentations imaginaires largement partagées dans le monde. Ce méga-texte est cependant largement dominé par la SF anglo-saxonne qui est traduite à travers le monde, ce qui n’est malheureusement pas le cas de la SF japonaise (même si c’est moins vrai en ce qui concerne les mangas ou les anime depuis les années 1980).
Ce manque de traductions pose un problème : le Japon existe avant tout en tant qu’image ou représentation. Parler de science-fiction japonaise, c’est donc évoquer un Japon science-fictionnel, un signifiant diffus qui circule dans l’imaginaire collectif depuis le japonisme de la seconde moitié du 19e siècle. Il se manifeste notamment dans la science-fiction New Wave nord-américaine lorsque des écrivains tels que Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin ou Roger Zelazny, fascinés par la spiritualité zen, font un appel nostalgique à la pré-modernité asiatique pour critiquer l’idéologie occidentale du progrès. À l’inverse, une décennie plus tard, c’est la version high-tech et hyper consumériste du Japon qui devient le cadre narratif de prédilection des œuvres les plus emblématiques du cyberpunk, aussi bien cinématographiques (Blade Runner, 1982), que littéraires (Neuromancien, 1984). Les lecteurs s’attendent donc à retrouver ce genre de représentations dans la SF japonaise, alors qu’elles sont nées de l’imaginaire nord-américain ou européen. Or elles y apparaissent bel et bien puisque les œuvres majeures de la New Wave ou du Cyberpunk ont été traduites en japonais et que les auteurs et autrices japonais s’en sont emparé dans un effet miroir. Il est pourtant difficile de mettre le doigt sur une spécificité de la SF japonaise tant les récits qui la composent sont variés et renvoient à peu près à toutes les sous-catégories du genre.
Je me contenterai donc de souligner plutôt quelques types de récits populaires au Japon qu’on ne retrouve pas (ou peu) ailleurs :
• Les récits romanesques (denki shôsetsu) qui s’apparentent à des uchronies ou à des récits alternatifs. Ils s’inspirent des récits chinois de la dynastie Tang et plus généralement des traditions, des légendes, des mystères chinois et japonais. Ils choisissent leurs thèmes dans les faits historiques mais y mélangent des éléments fictifs.
• Les récits extravagants (tondemohon). Ils sont généralement associés à des récits historiques qu’ils déforment de façon extravagante (d’où leurs noms), décrivant par exemple comment des extra-terrestres seraient apparus sur le continent de Mu. Ils sont très populaires parmi les amateurs de SF au Japon. Ils traitent souvent la question de l’origine des Japonais.
• Les voyages dans le temps sont aussi très populaires, notamment les boucles temporelles. Parmi les romans de voyage dans le temps, il y a de nombreux thèmes spécifiques : transcender le temps ou l’utiliser à des fins spécifiques, mais c’est celui de la boucle temporelle qui plaît le plus. L’une des premières œuvres à l’avoir mis en scène est sans doute La Traversée du temps (Toki wo kakeru shôjo, 1967) de Tsutsui Yasutaka. On y retrouve les éléments typiques de ce type de récits : une relation amoureuse, des amants que le temps sépare, une logique ou une cohérence temporelle qui force les personnages à réfléchir à leurs actions.
3. Comment a-t-elle évolué au cours du XXe siècle ? Peut-on dire qu’il y a eu un âge d’or de la SF japonaise de la même manière que l’on parle parfois d’un âge d’or de la SF américaine dans les années 30 à 50 ?
La science-fiction japonaise s’affirme véritablement à la fin de la 2nde Guerre Mondiale. À cet égard, il est intéressant de rappeler que l’âge d’or de la science-fiction américaine, lancé par les magazines pulps de la première moitié du 20ème siècle, était largement dominée par une vision idéaliste du progrès scientifique et se basait avant tout sur la « Grande Science », celle des projets de conquête de l’espace. La science-fiction japonaise s’est développée de manière différente. Le professeur et critique littéraire Tatsumi Takayuki évoque notamment comment la science-fiction américaine d’avant-guerre a renforcé l’idéologie de l’esprit de frontière, et partant celui d’un nationalisme parfois excessif. Il explique qu’à l’inverse, la science-fiction japonaise, quoiqu’elle apprît beaucoup de sa grande sœur, s’est construite par un effet miroir sur la défaite de la Seconde Guerre Mondiale, et que l’énergie créatrice qui en naquit, parfois de manière douloureuse, n’a jamais vraiment pu échapper à l’idéologie démocratique de l’après-guerre. C’est pourquoi la Hard SF, la fiction spéculative, la fantasy et les histoires de monstres (Kaijû) à la Godzilla ont émergé de manière simultanée dans les années 1950 et ont coexisté tout à fait sereinement. Dès ces débuts, la science-fiction japonaise a intégré les différentes traditions du genre de manière synchronique plutôt que diachronique, permettant ainsi la création d’une extraordinaire variété d’œuvres3.
Cette effervescence créatrice a donné aussi naissance à l’Association des Écrivains de Science-Fiction du Japon – SFWJ (Science Fiction & Fantasy Writers of Japan), dont la création en 1963 a précédé celle de son homologue nord-américaine de deux ans. Avec la maison d’édition Hayakawa, la SFWJ a non seulement œuvré à la promotion et au soutien des écrivains japonais, mais aussi à une large diffusion de la science-fiction étrangère via de nombreuses traductions. Au cours de cette période (années 1960-1970), ce sont les écrivains Abe Kôbô, Komatsu Sakyô, Hoshi Shin’ichi, Tsutsui Yasutaka, Mayumura Taku, Toyoda Aritsune ou Yano Tetsu, qui émergent et s’affirment comme les premiers maîtres de la science-fiction japonaise. Parmi eux, Hoshi, spécialiste de nouvelles très courtes, a d’ailleurs qualifié les années 1960 et 1970 d’âge d’or du genre au Japon, cette période d’après-guerre durant laquelle le pays observa une amélioration considérable des conditions de vie, et qui permit aux Japonais de pouvoir enfin se libérer des contraintes liées à la simple survie pour s’intéresser à nouveau au monde qui les entourait. Aussi Hoshi a-t-il pu écrire à propos de ces premières années d’après-guerre que « tout ceci remontait à bien longtemps. Fallait-il en attribuer la cause à l’apparition puis la diffusion de la télévision, aux prémices de la croissance économique, ou tout simplement à un changement d’orientation de la dynamique sociale ? Quoi qu’il en soit, une époque s’achevait ».4 L’épopée spatiale de Yuri Gagarin était devenue le symbole d’une nouvelle ère où les avancées scientifiques stimulèrent l’imaginaire de la société. Le Japon, fort de son succès économique, émergeait peu à peu comme un leader mondial dans le domaine des technologies de pointe, dans une période de prospérité propice à l’extrapolation : un espace de pensée orientée vers le futur que les écrivains de science-fiction ne manquèrent pas de s’approprier.
L’année 1970 constitue cependant une année charnière de remise en cause de l’idéologie de progrès au Japon, qu’elle ait des accents nationalistes, avec le suicide de Mishima Yukio en novembre, ou marxiste, avec les actes de terrorisme de l’Armée Rouge japonaise. Le choc pétrolier de 1973 va lui aussi contribuer à la remise en question de l’idée d’une croissance économique infinie. Le Japon résiste mais bascule dans l’ère de la consommation dont le quotidien individuel remplace le rêve d’un grand futur. La science-fiction des années 1970 continue cependant à se distinguer avec le succès de la New Wave, inspirée de J.G. Ballard qui influença un grand nombre d’écrivains au Japon.
Le Japon devient dans les années 1980 un pays science fictionnel, l’illustration même d’un futur technologique qui inspire les auteurs de cyberpunk nord-américains. Les écrivains japonais ne se lancent pourtant pas immédiatement dans l’aventure, avec l’exception notable de Masaki Gorô qui devient malgré lui le « Gibson japonais ». Ce sont plutôt les mangas et les anime qui reprennent les codes du genre et connaissent un retentissement spectaculaire en dehors du Japon qui exporte sa SF à l’étranger pour la première fois.
Le Japon doit cependant faire face dans les années 1990 à une grave crise économique et l’intérêt pour la SF littéraire commence à diminuer, forçant les éditeurs à trouver des parades. Apparaissent alors les light novels5, tandis que les jeux vidéo prennent de plus en plus d’importance et sont également adaptés sous la forme de romans. Le media mix – le fait qu’une œuvre ou une licence navigue entre plusieurs media – existait déjà depuis les années 1960, mais sa forme évolue. A cet égard le critique Ôtsuka Eiji (2001) explique que la notion d’une œuvre originale déclinée ensuite en plusieurs formats, laisse place à la création de concepts élaborés dès le départ afin d’être adaptés à plusieurs média.
Dans les années 2000, afin de promouvoir de nouveaux talents, Shiozawa Yoshihiro, rédacteur en chef d’SF Magjin, lance une nouvelle collection de science-fiction japonaise au sein de la maison d’édition Hayakawa. Il s’agissait d’encourager les publications de jeunes auteurs nés dans les années 1970, dont le style s’approchait d’une forme de « réalité-fiction ». Il lui semblait en effet que « les écrivains d’une vingtaine d’années, attribuaient intuitivement la même valeur à la réalité comme à la fiction, non pas dans le sens où la réalité devenait de plus en plus une illusion mais dans le sens où la fiction elle-même se muait en une forme de réalité à laquelle il fallait se confronter sérieusement » (Shiozawa, 2007). Cet effacement de la frontière entre réalité et fiction se matérialise aussi concrètement par les nombreuses incursions d’auteurs de « littérature pure » (jun bungaku)6 dans la science-fiction.
4. Comment est-elle perçue de nos jours ?
La SF littéraire ne semble pas se vendre autant qu’auparavant : les ventes ont baissé et SF Magajin, le premier magazine professionnel de science-fiction publié par la maison Hayakawa depuis 1959, est passé d’une publication mensuelle à bimensuelle à partir d’avril 2015. Toutefois, si l’on inclut les light novels, la SF japonaise se porte finalement plutôt bien.
Elle investit notamment la littérature « blanche » : les récents lauréats du prix Akutagawa7, que ce soient Kawakami Hiromi8 ou Hirano Keiichirô9 ont tous deux produits des textes science-fictionnels. Quand on pense à la SF en tant que genre, il est indéniable qu’il s’agit d’abord d’un marché que se partagent Hayakawa, Kadokawa ou encore Tokyo Sôgensha, et auparavant Tokuma, pourtant la SF a largement débordé son propre cadre et les auteurs de « littérature pure » n’hésitent plus à s’en emparer.
5. Comment la culture japonaise influence-t-elle la production littéraire de science-fiction ?
Comme je l’avais noté en réponse à la deuxième question, il existe des genres relativement spécifiques à la SF japonaise, et ceux-ci (notamment les récits romanesques) s’inspirent des contes et légendes japonais. Mais de nombreux récits reprennent également des thèmes ou des représentations « traditionnellement » présents dans la littérature ou le théâtre japonais. Je pense notamment à des thèmes tels que l’amour impossible et le double suicide amoureux. Il s’agit probablement plus d’une question géographique que culturelle (quoique l’environnement contribue en partie à modeler la culture), mais le fait que l’archipel soit sujet à de nombreuses catastrophes naturelles se retrouve dans la production de SF. Je pense à La Submersion du Japon de Sakyô Komatsu, mais aussi à Dai-yon kanpyôki (La 4ème période interglaciaire) de Kôbô Abe ou à Karyû no miya (Le Palais des dragons flamboyants) de Sayuri Ueda.
6. Vous dîtes dans un article pour la BULAC qu’« à l’aube du XXIe siècle, malgré le succès international des anime et des mangas, l’intérêt pour la science-fiction littéraire diminue ». Comment est-ce que cela s’explique selon vous ?
Je pense qu’il s’agit d’un phénomène paradoxal. D’un côté, la vente de romans ou de nouvelles à travers leurs supports « traditionnels » (les maisons d’édition historiques telles que Hayakawa, Kadokawa ou encore Tokyo Sôgensha) semble stagner, mais de l’autre les light novels se portent très bien. Comme je l’indiquais plus haut, les auteurs et autrices de littérature « blanche » se frottent aussi de plus en plus au genre depuis une ou deux décennies. L’imaginaire science-fictionnel déborde donc du cadre dans lequel les maisons d’édition, les auteurs et les lecteurs l’avaient « enfermé », si bien qu’il surgit à des endroits auxquels on ne l’attendait pas. De ce point de vue-là, l’intérêt pour la SF littéraire n’a peut-être pas tant diminué que ça.
7. En Occident, tout un pan de SF remet en question la présence excessive des nouvelles technologies. Il existe une sorte de peur de voir l’humanité renversée par les androïdes, les IA. Le Japon est le pays le plus robotisé au monde, toutes ces avancées technologiques effraient-elles le grand public comme elles peuvent le faire en Occident ?
Je pense que le Japon a été imaginé comme un pays robotisé à la pointe des technologies dans les années 1970 et 1980 (ce qui a donné naissance au cyberpunk nord-américain), mais la réalité me semble beaucoup plus nuancée. La SF y est d’ailleurs pour quelque chose : qu’il s’agisse d’Astro, le petit robot (la série créée en 1952 par Osamu Tezuka) du robot-chat Doraemon et de ses gadgets technologiques, ou encore de l'androïde Arale à la force surhumaine, les machines aux traits enfantins ont structuré l’imaginaire japonais depuis le lendemain de la guerre. Le manga de Tezuka, qui s’intitulait initialement Atomu taishi (Astro, le diplomate), a souvent été analysé comme le symbole de la fin de l’occupation américaine sur le territoire japonais et l’avènement d’une nouvelle période de paix, que le petit Astro fait tout pour préserver. Il a donc inspiré de nombreuses vocations scientifiques : la première tâche confiée à Masato Hirose, le père d’ASIMO, fut de créer un robot humanoÏde à l’image d’Astro. Mais l’imaginaire robotique ne se borne pas à ces robots enfantins : les robots géants tels que Mazinger Z et Goldorak, ou les armures mobiles de la franchise Gundam sont bel et bien des armes pilotées par l’humain. Dans les années 1990, la série Evangelion met en scène de gigantesques créatures organiques dotées d’une intelligence propre, avec lesquelles les pilotes doivent se synchroniser mais qu’ils ne contrôlent pas entièrement. Avec la popularité grandissante du cyberpunk, le software semble alors prendre le pas sur le hardware. La question de l’esprit et de la conscience (artificielle ou humaine), au cœur du manga Gunnm ou de la série Ghost in the Shell, supplante celle du corps qui, quoique nécessaire, devient interchangeable. Avec Pluto (2003-2009), Naoki Urasawa réinvente à son tour le personnage d’Astro en le présentant avant tout comme une intelligence artificielle complexe dont l’équilibre peut s’avérer fragile. Le manga d’Urasawa est largement plus sombre que celui de Tezuka. Les robots japonais ne sont donc pas tous aussi « aimables » qu’on pourrait l’imaginer, même s’ils permettent, dans toutes leurs formes, de réfléchir à la condition humaine.
Tout cela pour dire que je ne pense pas que le grand public japonais soit particulièrement effrayé par la présence excessive des technologies. Néanmoins, de nombreuses œuvres de SF japonaise présentent des horizons dystopiques (comme aux Etats-Unis ou en Europe), si bien que certains écrivains, tels que Taiyô Fujii, prennent le parti d’explorer les aspects positifs / salvateurs des sciences et des technologies – un peu à la manière du Solar Punk de Francesco Verso.
8. Les débats actuels autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la production visuelle et littéraire sont-ils d’actualité au Japon également ?
Ils le sont, même s’ils ont tardé à l’être. L’Association Japonaise des Écrivains de SFF (SFWJ) a publié une déclaration concernant l’utilisation de l’IA. Je l’ai traduite en anglais, disponible en cliquant ici.
Nous en avons longuement parlé lors des conseils d’administration qui ont eu lieu l’année dernière. Certains membres sont plutôt enthousiastes quant aux futures possibilités de l’IA, d’autres s’inquiètent des conséquences, notamment sur les droits d’auteurs, et appellent à un encadrement plus strict.
Chose intéressante, le prix Shin’ichi Hoshi, qui a débuté en 2013, est ouvert aux œuvres produites par IA, sous conditions (notamment que les textes n’enfreignent aucun copyright et que la personne responsable du prompt utilisé soit clairement identifiable).
9. Existe-t-il des prix littéraires récompensant la littérature de SF au Japon ?
Il y a d’abord eu le Concours de SF Hayakawa (Hayakawa SF kontesuto) qui a démarré en 1961. Sa forme a légèrement changé dans les années 1970, mais il s’est maintenu jusqu’en 1992 et a permis à de nombreux talents d’émerger. Lorsque la maison d’édition Hayakawa a décidé de l’arrêter, les écrivains de SF ont perdu leur porte d’entrée vers le monde professionnel. Ils se sont alors tournés vers le Prix du roman d’horreur (Kadokawa horâ taishô) instauré par la maison d’édition Kadokawa. C’est ainsi que Sena Hideaki10 a commencé sa carrière professionnelle, quoiqu’il eût peut-être préféré débuter chez Hayakawa. Il n’y avait plus de prix récompensant les nouveaux talents dans la SF. Le Prix de fantasy japonais a été créé en 1989 seulement, par la maison d’édition Shinchôsha en collaboration avec le journal Yomiuri et quelques entreprises partenaires (Mitsui fudô et Shimizu kensetsu). Le montant du prix était extrêmement élevé.
Depuis 1980, le Grand Prix de la SF au Japon (Nihon SF taishô), l’équivalent du prix Nebula aux Etats-Unis, est décerné chaque année par l’Association des Écrivains de Science-Fiction japonaise. Il existe aussi un équivalent des Hugo : le Prix Seiun, décerné par les fans et les lecteurs depuis 1970.
La fin des années 1990 a vu naître une controverse autour de la qualité de la SF au Japon. Elle a ébranlé le monde de l’édition et affolé les écrivains. Elle est partie du fait qu’en 1996 Gamera 2 region shûrai (Gamera 2 : L’Attaque des légions) a été le premier film à recevoir le Grand Prix de la SF au Japon. A l’origine, les membres de l’Association des Ecrivains de SF, notamment Sakyô Komatsu et Yasutaka Tsutsui, estimaient que le Grand Prix pouvait tout à fait être décerné à un manga ou à un film, voire à de la musique. Le journal Nikkei a cependant laissé entendre que si un film avait obtenu la distinction cette année-là, cela signifiait que tous les romans de SF qui sortaient à l’époque étaient mauvais, ce qui a lancé la controverse autour de la qualité de la SF au Japon. Plusieurs critiques, dont Kasai Kiyoshi, estimait que la SF était dans une période de crise parce qu’il n’y avait aucune récompense permettant de faire émerger de nouveaux écrivains. C’est alors que la maison Tokuma a lancé le Prix du nouveau talent japonais de la SF (Nihon SF shinjin-shô) en 1999. Il s’est malheureusement arrêté en 2009, mais sa création témoigne de la situation délicate dans laquelle se trouvait le monde de la SF au Japon à l’aube du XXIe siècle. Le Prix Hoshi Shin’ichi (Hoshi Shin’ichi-shô) a aussi vu le jour en 2013 grâce au travail de la fille d’Hoshi, Hoshi Marina.
Depuis 2020, l’Association des Écrivains de Science-Fiction japonaise a également lancé le Petit concours de SF (Sanakon) qui récompense les amateurs.
10. Quels auteurs ont marqué la littérature de SF au Japon ? Qui en sont les représentants de nos jours ?
Les trois plus célèbres sont bien entendu Sakyô Komatsu, Shin’ichi Hoshi11 et Yasutaka Tsutsui. Il y a à ce propos une nouvelle de Hirai Kazumasa, intitulée « Hoshi Shin’ichi no innâsupêsu » (« L’Espace intérieur de Hoshi Shin’ichi », 1970), qui décrit un Hoshi abasourdi sur sa chaise de directeur de l’entreprise pharmaceutique familiale alors en faillite, concevant les personnages de Komatsu, Tsutsui et tous les écrivains de la première génération, comme si la SF japonaise n’était que le fruit de son imagination12.
Avec la popularité de la New Wave, d’autres auteurs ont marqué le genre depuis les années 1960. C’est notamment le cas de Yoshio Aramaki, dont les premières œuvres mêlent l’esthétique surréaliste de Dalí ou les perspectives impossibles d’Escher à la pensée de Jung, ou encore de Chiaki Kawamata qui joue avec le surréalisme et la linguistique. Les autrices ne sont pas en reste avec Izumi Suzuki13 et Yûko Yamao14, même s’il était plus compliqué pour une femme de se lancer dans une carrière littéraire à cette époque. A présent, la tendance s’est presque inversée : Beaucoup des écrivains de SF sont des femmes. Sayuri Ueda15 a par exemple fait des débuts remarqués. Sayaka Murata évolue elle dans le monde de la haute littérature tout en écrivant des textes science-fictionnels. Ce n’est d’ailleurs pas la seule : Yoriko Shôno16, Rieko Matsuura17 ou Hiromi Kawakami18 naviguaient déjà entre la haute littérature et la science-fiction. C’est encore plus marqué chez Murata, elle fait partie d’une génération qui n’opère plus vraiment de distinctions et considère la SF comme quelque chose d’évident.
Côté hommes, Keikaku Itô (Project Itoh)19, Tô Enjô (Toh EnJoe)20, Hirotaka Tobi21, Satoshi Hase22, Yûsuke Miyauchi23, ou encore Hôsuke Nojiri24 sont les figures centrales de la SF au Japon.
11. Le Chant d'Auricularia et autres nouvelles, deuxième recueil de science-fiction publié chez Akatombo, traduit par vous-même en collaboration avec Tony Sanchez paraît cette semaine, pouvez-vous nous le présenter ?
Avec plaisir ! Nous avions choisi de mettre en avant les écrivains contemporains les plus populaires pour la première anthologie (La Machine à indifférence), notamment ceux qui appartenaient de près ou de loin au label « real fiction » que la maison Hayakawa avait mis en avant dans les années 2000. Les retours ont été plutôt bons dans l’ensemble, mais de nombreux lecteurs se sont étonnés du fait que les récits ne se situaient pas au Japon, tandis que d’autres ont regretté l’absence d’autrices. Nous en avons longuement reparlé avec Tony, et si la réaction des premiers nous a un peu surpris (pourquoi la SF japonaise devrait-elle forcément présenter des récits situés au Japon ?), nous nous étions fait la même remarque que les seconds lors du choix des nouvelles. Peu d’autrices figurent dans le label « real fiction », si bien qu’avec la question de la négociation des droits, il a été impossible d’en inclure une.
Nous avons donc décidé de présenter une sélection de nouvelles contemporaines dont les thèmes seraient plus variés, avec des autrices de renom et quelques auteurs peut-être un peu moins connus. Nous avons également fait le choix de ne pas nous en tenir à un label ou une maison d’édition spécifique (j’ai pris le temps de lire une bonne vingtaine d’anthologies et de recueils). L’idée était de présenter des œuvres où réalité et fiction s’interpénètrent. Mais aussi d’essayer de répondre aux attentes des lecteurs à qui la première anthologie avait paru manquer de « japonité » (même si je persiste à penser qu’il est intéressant de sortir des clichés habituels sur le Japon).
Toutes les nouvelles touchent de près ou de loin aux souvenirs et à la mort, ainsi qu’au rapport à l’autre. Après avoir sélectionné la nouvelle de Ueda (qui donne son titre à l’anthologie), une autrice que j’affectionne tout particulièrement, je me suis replongée dans les interviews qu’elle a données à différents magasines et journaux. Ueda, qui a longtemps travaillé dans des hôpitaux, y explique que la maladie et la mort font partie de son quotidien depuis toujours, si bien que pour elle, « écrire un roman, c'est un peu comme chercher des mots à adresser aux morts. Qu’est-ce que nous, les vivants ou les survivants, pourrions bien leur dire ? Pour y parvenir, il faut d’abord accepter tout ce qu’ils ont vécu. Jusqu’à leurs derniers instants. » Je crois m’être, un peu inconsciemment, inspiré de ses réflexions pour choisir les nouvelles de cette anthologie.
1 Il s’agit de la préface du roman de Suehiro Tecchô, Nijûsannen mirai ki (Les Futures Archives de l’année 1890), écrite par Ozaki Yukio en 1886. Ozaki y utilise pour la première fois le terme de « roman scientifique ». Voir Nagayama Yasuo, Nihon SF seishin-shi 日本SF精神史 (Histoire de l’esprit de la science-fiction japonaise), Tôkyô, Kadode shoten, 2009, p.52. L’ouvrage de Nagayama a remporté le Grand Prix de Science-Fiction Japonais en 2010.
2 Les romans de Verne ont connu un véritable boom au Japon, leur traduction presque immédiate. Le Tour du monde en quatre-vingts jours en 1878, De la Terre à la Lune en 1880 et Vingt mille lieues sous les mers en 1884.
3 Christopher Bolton, Istvan Csicsery-Ronay Jr. et Takayuki Tatsumi, (Dirs), Robot Ghosts and Wired Dreams, Japanese Science Fiction from Origins to Anime, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, p. 12.
4 HOSHI Shin’ichi 星 真一, Are kore kôkishin あれこれ好奇心 (Curieux de tout), Tokyo, Kadokawa bunko, 1988.
5 Romans destinés à un public de jeunes adultes. D’abord sérialisés à la manière de mangas, et comme ceux-ci souvent illustrés, ils sont par la suite publiés en livres de format poche. Ils sont souvent adaptés de ou en anime et mangas.
6Expression utilisée pour qualifier les œuvres d’une grande littérature, soi-disant plus sérieuse, par opposition à la « littérature populaire » (taishû bungaku).
7 Le prix Akutagawa est le plus prestigieux prix littéraire décerné au Japon.
8 Kawakami débute sa carrière en 1980 dans le magazine de science-fiction NW-SF (New Wave SF) édité par Yamano Koichi, avec la nouvelle « Sôshimoku » (« Le Diptère ») puis s’écarte du genre et publie de nombreuses œuvres, dont plusieurs ont été traduites en français, avec entre autres : le recueil de nouvelles Abandons (Oboreru, 1999) en 2003, Les Années douces (Sensei no kaban, 2000) en 2003, et plus récemment : Soudain, j'ai entendu la voix de l'eau (Suisei, 2014) en 2016. Ses œuvres produisent une atmosphère particulière qui vient du fait que ses univers fictionnels se construisent à travers la dissémination indirecte d’informations plutôt que par des descriptions précises. Sa nouvelle « Ugoromochi » (« Mogera Wogura », 2001) met par exemple en scène la vie quotidienne d’une taupe japonaise travaillant dans une entreprise, entourées par des humains.
9 Hirano remporte très jeune le Prix Akutagawa avec Nisshoku (1998), paru en France sous le titre L’Éclipse (2001), un roman mêlant théologie, métaphysique et alchimie. Hommage à Kafka, La Dernière Métamorphose, 2007 (Saigo no henshin, 2003), aborde la question des hikkikomori, le terme utilisé au Japon pour désigner les personnes qui s’enferment dans leur chambre et refusent tout contact avec l’extérieur. Plus récemment, entre le policier et le fantastique, Compléter les blancs, 2017 (Kûhaku wo mitashinasai, 2012), décrit la résurrection de milliers de suicidés, dont Tetsuo Tsuchiya qui est persuadé d’avoir été assassiné et se lance à la recherche de son meurtrier.
10 Auteur du best-seller Parasaito ivu (Parasite Eve, 1995).
11 Spécialiste de nouvelles très courtes (shôto shôto), il cofonde l’un des premiers fanzines japonais de science-fiction : Uchû-jin (Poussière cosmique) et devient le premier écrivain de SF professionnel au Japon. Ses nouvelles éludent les époques, l’environnement culturel direct pour s’offrir d’une manière universelle. Parmi les plus célèbres : « Bokko-chan » (1958), ou encore « Ôi detekôi » (1958), dont la traduction française intitulée « Ohé ! Sors de là ! » est parue en 2014 dans le numéro 28 du magazine Galaxies SF.
12 Après avoir étudié la chimie agricole à l’université de Tôkyô, Hoshi Shin’ichi reprend, à la mort de son père en 1951, les rênes de la compagnie pharmaceutique familiale : Hoshi Seiyaku, une expérience amère puisque l’entreprise, déjà en difficulté, fait faillite peu de temps après. Cet échec lui permet toutefois de se lancer librement dans l’écriture.
13 Née en 1949, Suzuki est à la fois l’icône d’une jeunesse libertine et autodestructrice – elle a travaillé comme hôtesse de bar la nuit, modèle de nu et actrice de cinéma érotique – et l’un des premiers écrivains à avoir exploré la question du genre dans la SF avec sa nouvelle « Onna to onna no yo no naka » (« Dans un monde de femmes et de femmes », 1977). À travers la description d’un futur dystopique dans lequel les hommes sont parqués dans une zone de résidence spéciale et les femmes sont contraintes à vivre entre elles et donc à s’entraider, Suzuki s’interroge sur les conséquences d’un monde exclusivement féminin.
14 Poète et écrivain de littérature fantastique, Yamao tire son inspiration du surréalisme. La destruction froide de mondes imaginaires créés au moyen d’un style aérien et poétique apparaît de manière récurrente dans ses œuvres. Elle remporte le concours de SF Hayakawa alors qu’elle est encore à l’université avec la nouvelle « Kamenbutôkai » (« Bal Masqué »), publié deux ans plus tard, en 1975, alors qu’elle a tout juste 20 ans. Impressionnée par les fresques du Palais Te réalisées par le peintre Giulio Romano, elle décrit dans « Enkinhô » (« Les Lois de la perspective », 1982) un univers cylindrique au sein duquel une pratique rituelle permet de maîtriser les lois de la perspective et de contrôler les perceptions visuelles des protagonistes. Yume no sumu machi (La Ville où résidait les rêves, 1982) apparaît parmi les 50 meilleurs œuvres de SF fantastique sélectionnées en 1985 par le magazine Gensô bungaku (littérature fantastique).
15 Ueda Sayuri se lance dans l’écriture après le séisme de Kôbe en 1995. Ses œuvres sont variées, mais c’est grâce à la SF qu’elle se fait connaître en remportant le prix Komatsu Sakyô avec Kasei no dâku barâdo (La Sombre Ballade de Mars, 2003). Figure emblématique d’une forme d’écocritique, elle connaît un immense succès avec Les Chroniques des océans (Ôshan kuronikuru) dont le premier volume, Karyû no miya (Le Palais des dragons de fleur), a remporté le Grand Prix de Science-Fiction Japonaise en 2011. Ueda explore régulièrement la question du genre, avec notamment Zeusu no ori (La Cage de Zeus) en 2004. L’un des aspects caractéristiques de ses œuvres réside probablement dans la façon dont elle resitue l’humanité comme une espèce parmi d’autres pour s’interroger sur ses possibles évolutions et ses relations avec les non-humains, à qui elle offre une large place. Sa dernière série, Yôkai tantei (Détective Yôkai), publiée entre 2014 et 2015, se teinte de fantastique et de fantasy. La traduction en français de la nouvelle formant la base des Chroniques des océans, « Uobune Kemonobune » (2009) est parue dans le numéro 39 du magazine Galaxies SF sous le titre de « Ichtyonaus, Thérionaus » (2016).
16 Shôno, dont les œuvres sont acclamées au Japon, a notamment remporté les trois plus grands prix littéraires : le Prix Noma, le Prix Mishima et le Prix Akutagawa. Les relations entre l’Etat et l’individu, le système impérial, le néo-libéralisme et les inégalités de genre font partie de ses thèmes de prédilection qu’elle aborde régulièrement à partir de personnages ou de divinités issus des mythes japonais anciens. Suishônai seido (Le Système dans un cristal, 2003) met par exemple en scène un Japon imaginaire dans lequel les mythes sont au service du Grand Empire et l’économie est entièrement basée sur l’énergie nucléaire. En renversant la structure des genres – les hommes sont bannis du pays sur la base d’une doctrine appelée « féminisme sale » (kittanai feminizumu) – Shôno critique les mécanismes de discrimination qui ont cours dans le Japon contemporain.
17 Les œuvres de Matsuura s’inscrivent dans une nouvelle forme de littérature féminine qui s’attache à déconstruire les codes sociaux et sexuels dans lesquels sont enfermées les femmes au Japon. Deux de ses romans ont été traduits en français : Nachuraru ûman (1987), paru sous le titre Natural Woman (1994) et Oyayubi P no shûgyô jidai (1993), paru sous le titre de Pénis d’orteil (2002). Le premier décrit les trois relations homosexuelles et homoérotiques ayant marqué la vie de la narratrice Yôko, tandis que le second met en scène Kazumi, une jeune étudiante découvrant plusieurs jours après le suicide d’une amie qu’un pénis a poussé à la place de son gros orteil droit.
18 Kawakami débute sa carrière en 1980 dans le magazine de science-fiction NW-SF (New Wave SF) édité par Yamano Koichi, avec la nouvelle « Sôshimoku » (« Le Diptère ») puis s’écarte du genre et publie de nombreuses œuvres, dont plusieurs ont été traduites en français, avec entre autres : le recueil de nouvelles Abandons (Oboreru, 1999) en 2003, Les Années douces (Sensei no kaban, 2000) en 2003, et plus récemment : Soudain, j'ai entendu la voix de l'eau (Suisei, 2014) en 2016. Ses œuvres produisent une atmosphère particulière qui vient du fait que ses univers fictionnels se construisent à travers la dissémination indirecte d’informations plutôt que par des descriptions précises. Sa nouvelle « Ugoromochi » (« Mogera Wogura », 2001) met par exemple en scène la vie quotidienne d’une taupe japonaise travaillant dans une entreprise, entourées par des humains.
19 Itô Keikaku est l’un des écrivains japonais de SF les plus populaires dans les années 2000. Webdesigner et auteur d’un blog de critique littéraire et cinématographique, il fait ses débuts avec le roman Gyakusatsu kikan (Organe génocidaire) en 2007. Héritier du courant cyberpunk, amateur de jeux vidéo, notamment des œuvres de Kojima Hideo dont il a novélisé en 2008 l’un des titres, Metal Gear Solid Guns of the Patriots, ses œuvres mettent en scène l’effondrement de la frontière entre réalité et simulation. Hâmonî (2008), traduit en français sous le titre Harmonie (2013), a remporté le Grand Prix de SF et le Prix Nebula des lecteurs en 2009, ainsi qu’une citation spéciale lors du Prix Philip K. Dick 2010. Itô est mort d’un cancer en laissant une nouvelle inachevée, complétée ensuite par Enjô Tô et publiée à titre posthume en 2012 sous le titre Shisha no teikoku (L’Empire des corps). La traduction en français de sa nouvelle « The Indifference Engine » (« La Machine à indifférence », 2012) est sortie en 2016 dans le numéro 39 du magazine Galaxies SF.
20 Physicien et mathématicien de formation, Enjô débute sa carrière littéraire avec le recueil de nouvelles Self-Reference ENGINE en 2007. Ses œuvres, de véritables expériences sur la forme rappelant parfois les exercices lipogrammatiques de l’OuLiPo, explorent des langages ou des niveaux de conscience inédits, si bien qu’elles s’avèrent d’une lecture difficile. Les personnages de la nouvelle « Boy’s Surface » (2007) sont par exemple une incarnation du concept mathématique de morphisme. « Silverpoint » (2011) offre une réflexion sur l’astronautique et l’astrodynamique narrée à partir des trajectoires esquissées par des lignes sur une carte. Il remporte en 2012 le prix spécial du Jury, décerné lors du Grand Prix de SF, ainsi que le prix Nebula des lecteurs pour Shisha no teikoku (L’Empire des corps).
21 Tobi fait ses débuts en 1982 dans SF Magajin avec la nouvelle « Porifonikku iryûjon » (« Illusion polyphonique »). Ses œuvres empreintes de thèmes mythiques et de motifs musicaux mettent régulièrement en scène des mondes programmables où les Intelligences Artificielles sont à la fois créatrices et actrices de leurs propres récits. Le recueil de nouvelles Katadorareta chikara (L’Énergie qui avait pris forme) remporte le Grand Prix de SF et le Prix Nebula des lecteurs en 2005. La traduction française de l’une d’entre elles, « Yoru to doro no » est parue dans le numéro 45 du magazine Galaxies SF sous le titre « De boue et de nuit » (2017). Sa série la plus populaire, Haien no tenshi (Les Anges du parc abandonné, 2002-2006) décrit les destins croisés d’humains et d’intelligences artificielles peuplant un immense parc virtuel.
22 Les premiers textes de Hase sont plutôt d’inspiration hard SF, mais il se fait connaître en 2009 avec le roman Anata no tame no monogatari (Un Récit pour toi) à partir duquel le thème de l’intelligence artificielle devient central. Après lui avoir fait écrire des récits de fiction, Hase l’incarne avec BEATLESS (2012) dans un Japon futuriste largement automatisé où les robots ont pallié le manque de main d’œuvre dû à la baisse du taux de natalité. De nouveaux prototypes ressemblant à de jeunes idoles s’échappent cependant d’un centre de recherches et leur intelligence est bien supérieure à celle de l’humanité. Hase remporte en 2015 le Grand Prix de SF avec le recueil de nouvelles My Humanity (2014).
23 Miyauchi débute sa carrière avec « Banjô no yoru » (« Une Nuit devant l’échiquier », 2010), la nouvelle éponyme d’un recueil qui remporte le Grand Prix de SF en 2012, dans lequel il explore le dépassement de l’entendement humain à travers le motif des jeux de plateau (échecs, dames, jeu de go, ou encore shôgi). L’année suivante, le roman Yohanesuburugu no tenshitachi (Les Anges de Johannesburg, 2013) qui aborde les attentats du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme à partir d’une multitude de points de vue différents – dont celui d’androïdes japonais, réceptacles potentiels de mémoires humaines, remporte le prix spécial du Jury du Grand Prix de SF.
24 Alors qu’il appartient à la génération cyberpunk et a travaillé comme programmeur CAO et concepteur de jeux vidéo, Nojiri écrit principalement de la hard SF, parfois sous la forme de light novels qu’il qualifie de goraku shôsetsu (« romans de divertissement »). La plupart de ses récits mettent en scène une héroïne, souvent lycéenne, et sont orientés sur l’exploration spatiale ainsi que la rencontre avec des formes de vie extraterrestre. C’est le cas de Fuwa fuwa no izumi (Les Fontaines de la légèreté, 2001) qui remporte le Prix Nebula des lecteurs en 2002, ou du roman Taiyô no sandatsusha (Les Usurpateurs du soleil, 2002), lauréat du même prix en 2003. Tous deux décrivent la possibilité d’une communication entre l’humanité et une forme de vie extraterrestre, ainsi que la possibilité d’atteindre un degré supérieur de conscience.
Un immense merci à Denis Tallandier pour avoir accepté de se plier à l'exercice d'un entretien écrit. Merci d'avoir pris le temps et de nous avoir offert des réponses fournies et passionnantes.