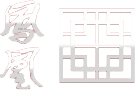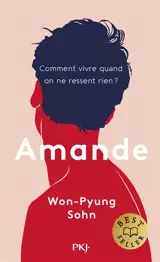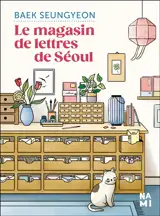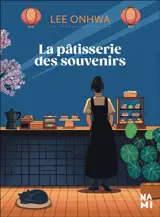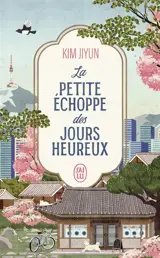De la santé mentale au K-healing : un nouveau genre littéraire sud-coréen

La santé mentale en Corée du Sud
Selon l’OMS, la santé mentale est un « état de bien-être qui permet à
chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales
de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et
d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ». Elle est notamment déterminée par de nombreux facteurs :
socio-économiques, biologiques et environnementaux, dont l’environnement
de travail.
En prenant en compte cette définition, et en tentant de l'appliquer à la société sud-coréenne, que pouvons-nous en conclure ?
De manière générale, la santé mentale est un sujet de plus en plus présent, dans le monde, comme en Corée du Sud. Pourtant, c'est également un sujet qui est la plupart du temps passé sous silence. Longtemps considéré comme un tabou, la santé mentale est encore souvent mise de côté au profit de l'image de la réussite et de la perfection, très ancrée dans la société coréenne d'aujourd'hui.
Que nous disent les chiffres ? En 2024, 83.6% des jeunes sud-coréens interrogés révèlent souffrir de "problèmes de santé mentale" contre 63.9% en 2022. Parmi les problèmes cités par la population interrogée, le stress aigu accompagne les idées dépressives et suicidaires. La préparation intensive au suneung (수능), l'examen de fin de lycée, accroit le stress dès le plus jeune âge, souvent à cause de la pression scolaire et sociale exercée sur les jeunes élèves. Le taux de suicide chez les adolescents est d'ailleurs l'un des plus élevés de l'OCDE.
Entre pression scolaire, compétitivité et normes sociales, la santé mentale des sud-coréens est mise à rude épreuve.
Malgré une amélioration des mentalités, la plupart des sud-coréens n'osent pas demander de l'aide de peur d'être rejetés. A nouveau, à cause de la pression exercée par les pairs, beaucoup restent réticents à l'idée d'en parler par peur de fragiliser leur carrière. Le rythme compétitif constant, lié au travail et à l'éducation, engendre un mal-être diffus.
Néanmoins, de plus en plus d'auteur.es utilisent le thème de la santé mentale comme élément central, ou secondaire, de leurs romans. L'exemple le plus parlant dans les éditions de ces dernières années est Amande de Sohn Won-Pyung : le personnage principal étant atteint d'alexithymie, un trouble neurologique qui l'empêche de ressentir et d'exprimer les émotions comme le ferait n'importe qui. Un trouble qui a donc des conséquences évidentes sur la socialisation, l'attachement à l'autre, et le développement émotionnel, mais qui engendre inévitablement cette marginalisation qui fait peur lorsque l'on doit s'exprimer sur la santé mentale.
Une marginalisation qui est également effleurée dans Le monde selon Sisun de Chung Serang. L'une des petites filles de Sisun est atteinte de PTSD, ce trouble répondant à un traumatisme. Elle se coupe du monde, elle change, et ne communique plus, se retrouvant isolée, y compris de son mari et du reste de sa famille.
La dépression est l'un des sujets les plus utilisés en littérature lorsqu'il s'agit de santé mentale, surtout liée à l'angoisse ou au stress. Nous le remarquons avec Moi, Moi, qui aborde parfaitement ces sujets avec le point de vue d'adolescents que tout oppose... Du moins en apparence, car c'est bien les questions de bien-être et de développement de soi à un âge où tout semble compliqué, qui vont les rapprocher. Entre pression sociale et deuil, ce sont des thèmes que chacun peut retrouver à des moments peu joyeux de sa vie. Un thème également bien présent dans Les boites de ma femme, qui plonge pleinement dans le mal-être conjugal, mettant en scène une femme dépressive et son mari, qui ne se rend compte de rien.
Comment clôturer cette introduction sur la santé mentale sans parler du best-seller Je veux mourir, mais je mangerais bien du tteokbokki, où l'on suit l'autrice dans sa lutte contre l'anxiété et la dépression, notamment par le biais de discussions avec son psychiatre. Paru en 2018 à la fois en Corée et aux États-Unis, il fut un succès immédiat en librairie dans la catégorie "essaie, non fiction".
De la santé mentale au K-healing...
On peut voir Je veux mourir, mais je mangerais bien du tteokbokki comme annonciateur d'un sous-genre littéraire, à la lisière entre la littérature et le développement personnel, très représenté sur nos tables à présent : le healing soseol (힐링 소설), appelé parfois K-healing, que l'on peut traduire comme une forme de "roman guérisseur" ou de "littérature thérapeutique". En effet, cela fait quelques années déjà que ce sous-genre a émergé, sous forme d'une tendance dont on peut maintenant commencer à déterminer des caractéristiques et des codes communs à plusieurs romans, que nous indiquerons ci-après.
Attention, le healing soseol est donc un terme qui a été adopté à postériori de la publication de la plupart des romans dont nous allons parler. Le healing soseol est une expression construite à partir d'un corpus pré-existant, dont émerge une tendance culturelle et sociale cohérente, sans que les autrices et auteurs en soient eux-mêmes particulièrement conscients, du moins avant la généralisation du terme healing soseol. De plus, ce sous-genre littéraire n'a pas encore été théorisé officiellement.
Cette forme de littérature thérapeutique pourrait se rapprocher d'un autre sous-genre littéraire déjà très présent et apprécié entre autres, dans la littérature japonaise : le feel-good. Ils partagent en effet quelques similarités, comme la présence de personnages en quête de sens qui connaissent une transformation personnelle au cours du roman, ou encore une résolution profondément positive.
Le healing soseol est une forme de roman dont la fonction première est de procurer un apaisement émotionnel et à aider le lecteur à traverser des moments difficiles, à réfléchir sur lui-même, et à atteindre une certaine paix intérieure. Souvent douce, introspective, bienveillante, parfois teintée de mélancolie, cette littérature est résolument tournée vers la reconstruction personnelle. Le healing soseol agit comme un miroir direct auprès du lecteur, qui n'aura aucun mal à s'identifier aux personnages traversant des situations similaires aux siennes, liées au burn-out, à la dépression, à un sentiment de vide et de solitude existentiel, à un manque de contact humain significatif qui ne soit pas dicté par les lois d'une société sans pitié. A tout cela peut s'ajouter aussi l'anxiété sociale, la fatigue urbaine et bien sûr l'absence de sens dans le quotidien.
Dans ces romans, les maux des protagonistes s'apaisent ou se règlent souvent grâce à une rencontre ou à un événement déclencheur d'une réalisation de son mal-être social suivie d'une transformation. Pour que cette "guérison" puisse avoir lieu, le cadre de l'intrigue est ramené à un environnement plus petit, plus personnel, plus rassurant. Par exemple, on trouvera dans ce genre des romans se déroulant presque uniquement dans un atelier, dans une librairie ou encore dans une laverie. Enfin, c'est un style d'écriture simple, accessible et centré sur les émotions, qui caractérise également le healing soseol.
Pourquoi nous paraissait-il intéressant de lier la problématique de la santé mentale au genre healing soseol ?
Comme indiqué précédemment, le message véhiculé dans les romans appartenant au genre est profondément optimiste et bienveillant. Plus encore,
il semblerait presque que ce genre littéraire doive agir comme une prescription au mal-être, d'où le nom "healing" : guérir. A travers la guérison des personnages, on ressent l'envie de "guérir", ou au minimum d'aider le lecteur. Dans certains romans, cela est encore plus clair, comme avec La fabuleuse laverie Marigold, dans lequel la propriétaire de la laverie souhaite "nettoyer les cœurs en effaçant les souvenirs les plus douloureux". Ici, le parallèle entre le lieu (la laverie) et l'action de nettoyer rend le message d'autant plus évident.
Les limites...
Au premier abord, nous pouvons donc émettre la supposition que ce genre littéraire paraît profondément bénéfique puisqu'il vise à épauler un lecteur ou une lectrice dans des moments difficiles. Quelques limites nous apparaissent malgré tout, qu'il nous semble utile de noter pour continuer à réfléchir sur la société coréenne et aux maux qui la traversent. Tout d'abord, d'un point de vue purement littéraire, nous pouvons questionner la rapidité exagérée de publication de ce genre de romans et le schéma répétitif des intrigues. Ce genre ayant également le vent en poupe à l'étranger (dans le monde anglophone comme francophone), il ne semble pas idiot de se demander si, en réponse à ce succès, des romans à caractères similaires et peu originaux continuent d'abreuver le panorama littéraire général, dans le but, non plus de guérir sincèrement les lecteurs, mais plutôt de gagner plus d'argent. De plus, nous pouvons nous demander si le healing soseol ne serait plus alors qu'une mode, dont le but initial serait complètement dénaturé en jouant sur le besoin des lecteurs de se sentir réconfortés dans une société qui ne convient pas à tout le monde. Par exemple, Une saison à l'atelier de poterie met en avant le burn-out d'une protagoniste qu'une vie professionnelle malheureuse et dépourvue de sens a finit par briser et qui va se reconstruire au contact des membres d'un atelier de poterie. C'est dans un retour à une occupation manuelle, plus ancrée dans la réalité, qu'elle trouve des explications à ses maux. Dans Bienvenue à la librairie Hyunam, la protagoniste décide de changer radicalement de mode de vie en réalisant son rêve d'enfance, malgré les nombreuses difficultés liées à l'ouverture d'une librairie, car elle avait perdu tout contact avec elle-même. On peut donc noter que ces deux romans mettent bien en avant des problèmes liés au fonctionnement de la société coréenne capitaliste. Ces romans peuvent participer à la création d'une réflexion active sur notre place à chacun dans la société. Ne cachent-ils pas le fait que le problème ne dépend pas toujours de l'individu, mais le plus souvent de la société au sens large ?
Nous arrivons donc à la question du pouvoir réel du livre. Un livre peut-il remplacer un traitement suite à un diagnostic et même plus ! Un questionnement plus profond sur l'état de la société ?
A méditer...
Sources :
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health_in_South_Korea
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6733113/
https://www.chosun.com/english/national-en/2025/03/28/XZEGJSSIYFF4VAUS2TULTJK4AM/